Les femmes de Massenet (Massenet II)
- Détails
- Publication : dimanche 9 janvier 2005 00:00
Si l'on part du principe que Massenet était le « musicien de la femme », il est logique de se demander qui furent les femmes réelles de la vie de Massenet, et de tenter de déterminer dans quelle mesure elles ont influencé son oeuvre.
Il n' eut pas d'homme public plus discret ni plus protecteur de sa vie privée que Massenet, au point qu'il ne se livre ni dans ses mémoires (mes souvenirs) ni dans sa correspondance. Ce sont en somme les petites notes dont il truffe le bas de ses partitions qui sont les plus révélatrices de ses états d'âme. Nous ne pouvons donc, en parlant des femmes de Massenet, que raconter des faits bruts, le reste étant simples conjectures.
Ninon
Au printemps 1865, Massenet, alors pensionnaire à la Villa Médicis, rencontra celle qui allait devenir son épouse, par l'intermédiaire de Franz Liszt. Celui-ci, invité aux soirées de l'Académie de France, aimait entendre les productions des jeunes pensionnaires, c'est à ces occasions qu'il se prit d'amitié pour le jeune Massenet, et il tarda pas à le recommander pour un poste de professeur de piano auprès d'une française qui organisait des réceptions musicales à Rome, Mme Orry de Sainte-Marie.
Étonnant personnage que celle-ci, et plus encore sa fille, Louise-Constance de Gressy. Toutes deux menaient une vie itinérante, comme c'était la mode pour les femmes de la bonne société de cette seconde moitié du XIX° siècle, séjournant quelques mois dans un endroit, puis dans un autre, prenant les eaux dans des endroits chics. Elles changeaient de ville, louaient un appartement et cherchaient un professeur de piano pour Louise-Constance, qu'on appelait plus souvent Ninon, très douée pour la musique.
La jeune fille était née en 1841 selon son contrat de mariage, mais en 1836 selon elle (Massenet était né le 12 mai 1842) de père inconnu, sa mère étant veuve lors de sa naissance. On l'appelait Mlle de Sainte-Marie, bien qu'elle ne soit pas déclarée sous le nom de sa mère, puisque née de parents « non dénommés », mais sous celui de Gressy, nom tombé en déshérence depuis le XIV° siècle. Le plus grand mystère entoure l'identité de son père, cette situation pouvant expliquer en bonne partie le caractère complexe et fantasque de Ninon.
Massenet tomba fou amoureux de sa nouvelle élève, au point dit-on de lui dresser un autel dans sa chambre de la villa Médicis, la jeune fille semblant quant à elle beaucoup plus réservée. La famille de Sainte Marie, mère, fille, fils, et Massenet partirent en excursion près d'Ostie, en mars 1865. Il se déclara avant son retour en France, mais la famille de Sainte Marie différa la réponse, peut-être effrayée par son avenir de musicien impécunieux.
De retour à Paris, Massenet entama une correspondance avec la mère, les usages d'alors ne permettant pas d'écrire directement à la fille. Ils se marièrent finalement le 8 octobre 1866 dans la petite église d'Avon, près de Fontainebleau. Ce mariage à la campagne (initialement projeté à Venise) dans la plus stricte intimité, s'explique par le fait que Ninon était née de père inconnu, malgré son nom ronflant, alors que c'est Massenet qui avait un peu de sang bleu dans les veines, à la fois par sa mère, Eléonore-Adélaïde Royer de Marancour, et par sa grand-mère paternelle, Françoise-Hélène Mathieu de Faviers.
Le 31 mars 1868 naquit leur enfant unique, Juliette.
A quoi ressemblait leur vie de couple ? En lisant notes et courriers, on ne ressent pas ce que décrit Massenet dans mes souvenirs, « Mon épouse aimée, la compagne toujours attentive, souvent inquiète, de mes jours, témoin de mes défaillances comme de mes sursauts d'énergie, de mes tristesses comme de mes joies. C'est avec elle que j'ai gravi ces degrés longs déjà de la vie ». On a beaucoup plus l'impression que Ninon n'était jamais présente. A partir de 1876 la situation du ménage s'améliora nettement, et Ninon repris ses habitudes itinérantes, Plombières, Biarritz, infatigable voyageuse passant au moins six mois par an d'une cure à l'autre, le plus souvent avec sa fille. Massenet ne s'habitua jamais à la solitude et aux longues absences de sa femme, comme le montrent les notes de bas de ses partitions : « dimanche 13 juillet 8h du matin / après une nuit sans sommeil / le cœur triste.. comme le ciel en ce moment.». Ou encore page 71 du manuscrit de la Vierge : « N[inon] et J[uliette] quittent St. Moritz. Vendredi 2 août 1878. 3.25 minutes. Je suis seul ». Le jour de ses quarante-trois ans en mai 1885, il est seul à Marseille et note sur sa partition « seul et triste ».
Lui-même voyageait d'ailleurs beaucoup, mais de son coté, la célébrité venant, pour son métier. Il participait aux créations de ses ouvrages dans toute l'Europe, donnant ses indications aux chefs d'orchestre, aux metteurs en scène, aux artistes, aux costumiers.
En revanche, si Ninon était rarement aux cotés de son époux, elle réclamait un certain train de vie. Jusqu'à la nomination de Massenet au conservatoire le 1er octobre 1878, les leçons particulières de piano étaient le principal moyen de subsistance du couple. Le 30 novembre 1878, élu à l'institut, il arrêta de donner des leçons. Selon Pierre Bessand-Massenet, il semble que ce soit son éditeur, Georges Hartmann, qui ait poussé Massenet à s'en débarrasser, malgré l'opposition de son épouse, qui n'entendait pas se priver de ces ressources. Cet abandon était pourtant indispensable à Massenet pour dégager le temps indispensable à la composition.
Un fait troublant : en 1908, Juliette divorça. Alors que Massenet lui apporta soutien et affection, Ninon refusa de voir sa fille pendant des années.
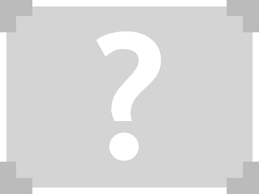
Sibyl
En 1887, lors d'un dîner, Massenet rencontra Sibyl Sanderson et sa mère à la fin du repas. Elle avait vingt-deux ans, américaine, fille d'un juge suprême mort en laissant une confortable fortune mais la jeune femme, si elle n'avait pas besoin d'argent, voulait monter sur les planches. Il l'accompagna au piano, et « par modestie », ne voulant pas chanter du Massenet, elle interpréta un air de la Reine de la nuit. Ce fut le coup de foudre, amoureux ou vocal ? Les deux semblent étroitement liés.
D'après d'autres source, ce fût Ruggero Leoncavallo qui recommanda la jeune cantatrice au compositeur. Les deux ne semblent pas incompatibles.
Tous les témoins de l'époque s'accordent sur la grande beauté de Sibyl Sanderson, ainsi que sur sa bonté. Sur ses capacités vocales, les avis sont plus partagés : si Massenet loue l'étendue de sa voix et son splendide contre-sol, d'autres mentionnent un manque de puissance et un trou dans le médium.
Conquis, le maître, âgé de quarante-cinq ans, décida de composer pour elle Esclarmonde, lui qui n'avait jamais écrit pour une interprète particulière ni même pour un théâtre particulier, mais pour commencer il la fit travailler en prévision de la création de Manon à La Haye au début de 1888, apportant des modifications légères, mais nombreuses, à sa musique pour mettre sa voix en valeur et il lui offrit une partition dédicacée « Nulle voix n'a de plus doux accents, nul regard plus de charme avec plus de tendresse, opinion de la presse et la mienne aussi, pendant cette première soirée qui n'a été qu'une suite d'ovations » à son retour de La Haye.
Il lui offrit également la première épreuve de la partition d'Esclarmonde, lui demandant d'apposer sa signature à coté de la sienne à la fin du manuscrit.
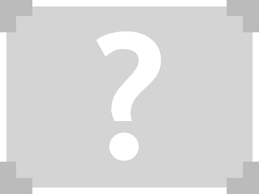
En août 1888, Massenet se rendit à Vevey, en Suisse, avec Sibyl Sanderson et sa mère, afin de lui faire travailler Esclarmonde et de retoucher la partition. Un incident dévoila l'idylle au grand jour : au cours d'une promenade en barque, Massenet tenant les rames, le couple fut surpris par la tempête, et ne dût son salut qu'au passage d'un bateau. Le compositeur offrit un dédommagement au capitaine afin qu'on ne souffle mot de l'histoire, ce qui enflamma les esprits dès l'aventure connue.
Pourtant, en l'absence de preuve formelle, incontestable, il est impossible de conclure quoi que ce soit des relations entre Massenet et Sibyl Sanderson. Beaucoup, dont Gérard Condé, pensent qu'elles furent platoniques. On sent en effet entre eux plus des rapports de maître à élève, ainsi que de la part de Mmes Sanderson mère et fille, une ambition les amenant à utiliser le maître pour parvenir au faîte de la gloire, quand bien même en l'affectionnant. Sibyl Sanderson était une diva, elle en avait le tempérament, Massenet lui-même dans un courrier se plaignait de « leurs caractères impossibles ». (mère et fille)
En 1892-93, Massenet promit une nouvelle œuvre à l'Opéra-Comique, Thaïs, avec son égérie dans le rôle-titre, mais celle-ci, alléchée par de meilleures propositions de l'Opéra, quitta la troupe, bientôt suivie par Massenet avec sa nouvelle œuvre. Or, un opéra de Massenet, c'était le succès assuré, et on peut se demander si cela n'a pas été pris en compte dans les tractations entre la cantatrice et la direction de l'Opéra.
Dédicataire encore de deux mélodies : beaux yeux que j'aime (tout un programme, et qui fit jaser !) En 1891 et l'une de ses plus célèbres, pensées d'automne en 1893, la belle Sibyl promena un peu partout, à Londres, Paris, Bruxelles, ses Esclarmonde et ses Manon, puis quitta la scène en 1897. Elle épousa la même année un riche planteur américain d'origine cubaine, Antonio Terry, qui mourut en décembre 1898.
Elle revint en France, parla de faire sa rentrée, remonta un peu sur scène : Phryné de Saint-Saëns (écrit pour elle en 1893), Circé de Hillemacher, et même Manon au Metropolitan Opera. Hélas, Massenet lui-même écrivit à Ninon en 1901 que la voix de Sibyl n'était plus qu'un souvenir. Il lui avait promis Grisélidis, alors à l'état de projet, en 1894, mais la créatrice de 1901 fut Lucienne Bréval, preuve que Massenet ne sacrifiait pas son art à son affection. Sibyl fut très affectée de cette désertion.
Elle sombra dans la neurasthénie et l'alcoolisme et mourut à Paris le 15 mai 1903, d'une grippe maligne, à trente-huit ans.
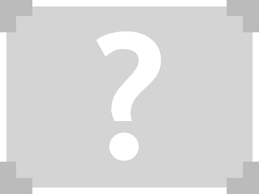
Lucy
On ignore dans quelles circonstances Massenet fit la connaissance de Georgette Wallace, dite Lucy Arbell. En 1901, il lui dédia la mélodie On dit, elle avait dix-neuf ans et lui atteignait la soixantaine, et une autre, les yeux clos en 1903, année de ses débuts dans Dalila. C'était la petite-fille (ou petite-nièce) du milliardaire américain Richard Wallace, qui dota Paris des fontaines d'eau potables qui portent son nom.
Les choses sérieuses commencèrent en 1905, quand Massenet étoffa le rôle de Perséphone dans Ariane, à son attention, lors d'un séjour dans la propriété de Lucy à Saint-Aubin, alors que l’œuvre était quasi-achevée. En particulier, il rajouta l'air de Perséphone « des roses, des roses ». Il nota sur la partition piano-chant manuscrite dont il lui fit cadeau « cette page a été conseillée par Mlle Georgette Wallace et j'ai écrit cela d'après son impression ». Ensuite, les roses devinrent une sorte de code entre eux.
Car il y a beaucoup plus de guimauve dans leur relation que dans les précédentes. Certains ont voulu y voir l'effet du gâtisme chez Massenet, allégations qui ne peuvent salir que ceux qui les profèrent. Mais il est vrai que les derniers chapitres de mes souvenirs, sont, à mots couverts, un hymne d'amour sa nouvelle égérie. Et puis, d'autres petites choses : Belle Dulcinée, l'héroïne de Don Quichotte, est presque l'anagramme de Lucy Arbell, et, toujours dans mes souvenirs, le compositeur note que « Don quichotte arrivait comme un baume dulcifiant dans ma vie », allusion à peine voilée, jeu de mot entre dulcifiant, Dulcinée, et donc Lucy.
Autre chose ? Il voulut que le décor du premier acte de Thérèse, composé pour elle, rappelle exactement le pavillon de Bagatelle, édifié en 1720 par le maréchal d'Estrée pour sa très jeune femme. En 1775 le comte d'Artois, âgé de 18 ans, frère cadet de Louis XVI devint propriétaire, fit raser et reconstruire le pavillon. En 1835, Lord Yarmouth, futur marquis d'Hertford l'acheta, l'agrandit et le légua à sa mort à son fils naturel sir Richard Wallace, grand-père de la jeune femme.
Mais ceci ne sont que des anecdotes. Lucy Arbell, intelligente et fine musicienne, fut la seule parmi les femmes de Massenet à lui prodiguer des conseils. En 1906 Massenet se fit installer le téléphone et l'appelait souvent pour lui demander son avis au sujet de ses compositions. C'est elle qui lui souffla l'idée de mêler chant et déclamation, et proposa le nom de l’œuvre, Les expressions lyriques. Le texte de la mélodie Mélancolie pourrait être d'elle. Une véritable muse.
Outre Perséphone, Belle Dulcinée et Thérèse, Massenet composa pour elle le rôle d'Amahelly dans Bacchus, Colombe dans Panurge, et celui de Posthumia, la vieille aveugle, dans Roma. Ce n'est pas le premier rôle mais c'est le plus dramatique, celui tenu par Sarah Bernard dans la pièce. Il commença d'ailleurs la composition par la scène de Posthumia. En effet, Lucy Arbell était une vraie tragédienne, dotée d'un solide tempérament dramatique, mais les critiques étaient plus réservés au sujet de sa voix. Alfred Bruneau la traita même de « contralto blafard » !
Massenet lui destinait également le rôle-titre de Cléopâtre, nous verrons ce qu'il en advint.
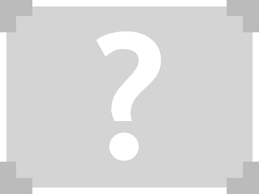
A partir de 1904, Massenet prit l'habitude de séjourner alternativement dans sa propriété d'Egreville et dans celle de Lucy Arbell à Saint-Aubin sur la côte normande.
Voilà qui est encore révélateur : alors que Ninon n'avait jamais montré d'aigreur envers Sibyl Sanderson, elle prit très mal la relation de son mari avec Lucy Arbell, écrivit d'un ton acerbe à Juliette que Massenet était chez «son amie» (elle qui n'était jamais là !) et parlait d'elle comme d'une créature. On dit même qu'elle appela Lucy la première vache née à Egreville !
Les premiers symptômes du cancer des intestins qui allait emporter Massenet se manifestèrent en 1908, mais il ne commença à en souffrir vraiment qu'à partir de 1910-1911. Il entra à l'hôpital pour des examens, et dès qu'il en sortit, Ninon, « tranquillisée », retourna à Egreville, lui conseillant d'aller plutôt passer sa convalescence à Saint Aubin. Elle partit ensuite en cure à Vichy, tandis que Massenet encore chancelant, séjournait une deuxième fois à Saint Aubin.
La maladie poursuivit sa progression, malgré les attentions de Lucy Arbell. En juin 1912, le compositeur termina Cléopâtre seul à Paris, sa femme était en voyage depuis mai, il ne la revit pas avant fin juillet. Début août à Egreville l'état de Massenet s'aggrava brusquement, il rentra seul à Paris consulter son médecin, et mourut le 13 août à quatre heures du matin à la clinique de la chaise où il avait été hospitalisé.
Massenet avait précisé dans un codicille à son testament (18 janvier 1912) :
Je désire d'une façon absolue pour la création du rôle d'Amadis Mlle Lucy Arbell de l'Opéra.
Cette remarquable artiste créera ce rôle et chantera les représentations qui suivront dans le théâtre où l'on jouera Amadis, opéra légendaire en 4 actes, poème de Jules Claretie, de l'Académie française, musique de J. Massenet.
Je signe cette déclaration en cas de ma mort et si l'ouvrage est représenté, soit de mon vivant, soit après ma mort.
Signé : J. Massenet
Je désire que les représentations d'Amadis dans les théâtres de France ou d'étranger soient donnés avec cette interprète, Lucy Arbell.
Le rôle de Cléopâtre a été écrit pour Mlle Lucy Arbell 10, avenue de l'Alma, Paris.
C'est elle [souligné deux fois] que je désigne pour la création de ce rôle et les représentations qui suivront de cet ouvrage : Cléopâtre.
Signé : J. Massenet
Paris, le 29 mai 1912.
Et un troisième codicille :
Le rôle d'Amadis dans Amadis sera créé par Mademoiselle Lucy Arbell, 10 avenue de l'Alma Paris.
C'est elle que je désigne pour cette création à Monte-Carlo & à Paris et aussi dans les autres théâtres qui joueraient aussitôt. Et puis, pour la suite des représentations.
Signé : J. Massenet
29 mai 1912
Massenet disparu, l'attitude de Ninon envers Lucy changea. En 1914, on choisit Marie Kouznetsov pour le rôle de Cléopâtre, au mépris des volontés du défunt. La nouvelle titulaire était soprano, qu'importe ! On transposa la partition en plus de trois cents endroits pour lui permettre de chanter ce rôle écrit pour contralto.
Lucy Arbell intenta un procès, et le gagna ; mais le jugement fut cassé pour vice de forme. La première guerre mondiale éclata ; l'affaire fut classée sans suite. Lucy fut de la même façon écartée de la création d'Amadis et d'un projet de film La Navarraise.
Lucy Arbell ne chanta Cléopâtre qu'à Bordeaux et à Nantes. Elle abandonna le théâtre en 1922 pour se consacrer à des oeuvres charitables. Elle mourut à Paris en 1947, à l'âge de 65 ans.
Il existe un autre codicille, très émouvant, au testament de Massenet (rappelons qu'il n'est pas ici question d'argent, la famille Wallace étant très riche) :
29 août 1909
Je désire qu'après ma mort, une somme de dix mille francs (frais de succession payés afin que la somme soit nettement de dix mille francs) soit donnée de ma part à Mlle Georgette Wallace demeurant à Paris 10 avenue de l'Alma.
Cette somme devra servir à l'achat d'une perle ou d'un bijou que Mlle Georgette Wallace achètera aussitôt elle-même.
Signé : J. Massenet
A Paris, 48 rue de Vaugirard
Ceci est un souvenir de son dévouement pour moi et mon admiration pour l'artiste.
D'après les témoignages, Lucy porta jusqu'à la fin de sa vie un sautoir de perles d'ambre
Texte de Catherine Scholler, décembre 2004-janvier 2005.
L'iconographie de ce dossier est tirée du site http://www.jules-massenet.com
Le volet précédent de cette série sur Massenet s'intitule Il faut déringardiser Massenet
Copyright © de ODB Opéra Tous droits réservés.



