Ariane, la déterminée (Massenet III)
- Détails
- Publication : mercredi 16 février 2005 00:00
Création à l'Opéra de Paris le 31 octobre 1906
Ariane : Lucienne Bréval
Phèdre : Louise Grandjean
Perséphone : Lucy Arbell
Thésée : Lucien Muratore
Pirithoüs : Jean-François Delmas
Chef d'orchestre : Paul Vidal, élève de Massenet
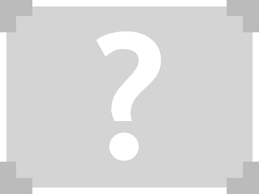
Mélomanes, curieux de Massenet, ne cherchez pas de version discographique d'Ariane ! Aucun enregistrement officiel n'en existe, et l'unique captation privée qui circule est d'un son impossible et d'une distribution des plus aléatoire ! A circulé également une Ariane de Paris en 1994 avec Michèle Command, écho d'un concert privé accompagné au piano. On trouve pour terminer cette discographie très exhaustive trois extraits de l'œuvre dans un récital de Rosamund Illing dirigé par Richard Bonynge, enregistrement à commander en Australie ! Il vous faudra donc patienter jusqu'à, non pas la prochaine biennale Massenet, mais la suivante, en 2008, pour entendre enfin cette œuvre envoûtante !
Ariane, seizième opéra de Massenet, est le fruit d'une collaboration avec Catulle Mendès . Tout a été dit sur son compte dans le feuilleton consacré à Chabrier sur ce même site : mondain, carriériste, figure intellectuelle ? voire imposture intellectuelle - de son temps, jouissant d'une forte popularité, il était à cette époque considéré comme un homme de lettres de talent. La postérité l'a heureusement remis à sa place, en l'oubliant complètement.
Les deux hommes se connaissaient de longue date, car les noms de l'un comme de l'autre figuraient quotidiennement en bonne place dans les journaux, que ce soit à la rubrique musicale, théâtrale ou mondaine, et ne semblaient pas particulièrement s'apprécier, quoiqu'en dise le laudatif Mes Souvenirs. Le critique avait eu la dent dure vis-à-vis du compositeur qui ne représentait en rien son idéal wagnérien.
Il semble que cette improbable collaboration soit due d'une part au besoin pressant d'argent de l'un, d'autre part à l'impérieuse envie de mettre en musique la légende d'Ariane de l'autre. Elle devait donner ensuite lieu à un autre ouvrage, Bacchus, qui, bien que distinct, devait former un diptyque. Le livret d'Ariane est généralement jugé désolant, mièvre, de mauvais goût et d'un érotisme cru. On a suggéré que Massenet a accepté ce livret par sénilité, ce qui est ridicule. Tout simplement, même sur un mauvais texte, Ariane reste une héroïne massenétienne, libre et déterminée, une femme qui reste fidèle à son amour, amour pour Thésée mais également pour sa sœur Phèdre, malgré la trahison : elle va jusqu'au bout de ses choix.
On peut se gausser du style prétentieux et ampoulé, des improbables vers de mirliton de Catulle Mendès, il n'empêche que de tous les livrets d'opéra qu'il écrivit : Bacchus pour Massenet, Gwendoline et Briséis pour Chabrier, La Carmélite pour Reynaldo Hahn, Rodrigue et Chimène pour Debussy, Ariane est, de loin, le moins mauvais. Bien sûr, il recèle quelques perles, dont la plus belle est à coup sûr :
Thésée : Ariane, corolle
De l'abeille toujours du désir renaissant,
Comme le mien !
Ariane : Voilà la plus chère parole !
Et tu pouvais la dire en te taisant
Mais on peut citer encore, pour le plaisir :
Thésée : ?les soirs, tu m'attends
Sur le seuil, haletante,
Et les seins battants. [?]
Et maintenant le dieu t'enfièvre
D'un oestre plus délicieux?
Ne cherchez pas la définition du mot « oestre » dans le dictionnaire, il fait référence au cycle féminin, et si l'on y regarde à deux fois, Thésée raconte à Phèdre qu'elle a les seins qui tombent et qu'il aime son ovulation, ce qui, chez toute autre qu'elle, devrait déclencher une immédiate paire de claque !
Mais cessons de rire, car le livret est bien construit, les situations sont puissantes et les passions bien dessinées, proche du scénario d'un film, certains vers sont même fort beaux, par exemple ceux du lamento final d'Ariane :
Et me voici seule laissée,
Si blessée
Et plus jamais caressée !
Ou encore les imprécations de Phèdre :
Atroce Éros !
Apre Cypris !
Votre détestable victoire
Dans l'enfer de mes esprits
Rôde comme une torche noire ! [?]
S'il vient, je défaille,
S'il s'en va, je meurs !
On note que tous ces vers, les bons comme les mauvais, sont particulièrement explicites. Jusqu'ici, c'était la musique de Massenet que l'on qualifiait de « luxurieuse » sur des textes plus prudes. Dans Ariane, Catulle Mendès se montre d'une érotomanie sans vergogne. C'est assez surprenant?mais pas si désagréable !
La musique est de son temps, 1906, puissante, somptueusement orchestrale, et pourrait clouer le bec à tout thuriféraire de « Massenet compositeur de musique facile ». L'œuvre obtint un joli succès à la création, soixante représentations, mais fut par la suite assez peu reprise, la faute, dit-on, au livret. Excuse facile ?
L'acte un se déroule en Crête. Des sirènes chantent au loin. Les marins attendant le retour de Thésée, entré défier le Minotaure dans le labyrinthe, sont tentés de les rejoindre, mais en sont empêchés par le fidèle Pirithoüs (baryton - air « arrêtez, cœurs d'enfants »). Ariane (soprano), qui a donné le fil à Thésée, atteint, épuisée, la porte du labyrinthe, et adresse une prière à Cypris, autre nom d'Aphrodite. Sa sœur Phèdre (soprano dramatique) s'étant aperçue de sa disparition, est partie à sa recherche. Ariane lui explique son amour (air : « avec tes compagnes guerrières »), Phèdre lui reproche de trahir leur propre frère, le Minotaure, pour un étranger, un ennemi de la Crête, et maudit Cypris, que, elle-même dédiée à Artémise, ne peut comprendre. Mais Ariane a choisi cet homme et ira, seule, sans appui, libre et courageuse, jusqu'au bout de son choix, qui la mènera de la trahison de son sang à son abandon sur l'île de Naxos (splendide duo « ô la plus chère de mes sœurs).
Le combat entre Thésée (ténor) et le Minotaure commence. Il se déroulera entièrement en coulisse, commenté par Ariane, Phèdre et Pirithoüs, excellent artifice évitant de montrer un monstre en carton-pâte et un combat sur scène. Le chœur des vierges et des éphèbes (sopranos et sopranos travestis) promis au sacrifice, intervient en contrepoint, augmentant la tension de cette scène, vraiment palpitante. Un grand moment de théâtre.
Le héros vainc le monstre, acclamé du chœur de liesse des vierges et des éphèbes. Il s'approche d'Ariane et lui demande de l'accompagner vers sa demeure, où il l'épousera. Phèdre, troublée par Thésée, demande d'une façon équivoque à accompagner sa sœur.
Le final de l'acte est relativement passe-partout, et pour tout dire, un rien pompier.
L'acte deux se passe sur la galère ramenant de Crête Thésée, victorieux, Ariane et Phèdre. L'introduction, élégiaque, décrit une mer d'huile, un ciel serein et un équipage de marins oisifs. Délos est en vue.
On n'a pas besoin de deviner à quoi Thésée et Ariane passe leur temps, le livret est suffisamment explicite (duo « J'ai dormi »). L'indigence et la niaiserie de leurs propos sont proprement insupportables. Mais, même s'il est permis de supposer que Catulle Mendès ne l'a pas fait sciemment, cette mièvrerie sonne juste : qui n'a jamais eu envie d'étrangler parmi ses amis un couple fraîchement formé, enfermé dans sa bulle et débitant des fadaises ? Nous avons tous connu ce genre d'agacement ! Phèdre souffre, et appelle de ses vœux la tempête, avec une exaltation mêlée d'effroi.
L'orage donne lieu à de remarquables passages chromatiques à l'orchestre, ponctué d'interventions du chœur et des exclamations de Pirithoüs et de Phèdre. On note une certaine symétrie entre les deux premiers actes : une introduction relativement longue, avec chœurs et comprimari, et une scène d'action, bataille ou tempête, dans lequel le chœur joue un rôle musicalement original permettant de faire monter la tension.
Mais la tempête se calme vite, et pousse le navire vers Naxos, sur le retour du thème paisible de l'introduction de l'acte.
L'acte trois, situé à Naxos, débute de nouveau par une longue introduction, uniquement instrumentale cette fois-ci, qui plante le décor d'une île sauvage et giboyeuse. Des sonneries de cor dans le lointain décrivent la chasse menée par Phèdre.
Les relations entre les personnages ont changé : Thésée se détache progressivement d'Ariane et tombe amoureux de Phèdre, qu'il reconnaît comme son égale dans les activités guerrières, qui ne sont pas l'apanage de sa douce épouse. C'est, sur le plan des passions, l'acte le plus réussi, les sentiments des protagonistes sont complexes, plus intéressants que dans la plupart des livrets d'opéra, bien souvent monolithiques.
Thésée est bourrelé de remords, il déserte le lit conjugal sans vouloir avouer ses sentiments ni à l'une, ni à l'autre. Son ami Pirithoüs l'incite à quitter Naxos au plus vite et redevenir lui-même (air de Thésée ? oui, j'achèverai d'un cœur résolu).
Ariane, qui souffre de la désaffection de Thésée mais n'en connaît pas la raison, est consolée dans un ravissant morceau par Eunoé accompagnée de sa lyre. Elle charge sa sœur Phèdre de parler en son nom à son époux dans un air (« ah ! Je comprends ! Un héros ! Un roi? ») dépeignant toute la tendresse entre les deux sœurs : « Nous avions des instincts secrets/Et tout pareils, sans nous les dire/Tu pleurais dès que je pleurais/Et je riais de te voir rire ». Car Phèdre est à Ariane ce que Sophie est à Charlotte, ce que Parséis est à Esclarmonde, et même un peu plus étoffée : une amie, une alliée, pas une rivale. On sent dans l'indéfectible affection d'Ariane, de même que dans les refus et les remords de Phèdre, que la complicité a existé entre elles pendant de longues années. La concurrence féminine n'est pas massenétienne.
Une fois seule, Phèdre, remplie d'effroi, tiraillée entre sa passion pour Thésée et son amour pour sa sœur, lance des imprécations, dans un air d'une orchestration fiévreuse (« oui, oui, j'accomplirai cette tâche sacrée ») reflétant les tourments de son âme. Elle tente ensuite, dans une forme rondeau, de convaincre Thésée d'aimer de nouveau Ariane, mais celui-ci, en une déclaration d'inspiration très gluckiste, lui avoue ses sentiments, dont il a honte. Ils sont petit à petit, et malgré eux, emportés dans un duo passionné, et sont surpris dans les bras l'un de l'autre par Ariane.
Phèdre, saisie d'horreur, s'enfuit en reprenant sa malédiction à Cypris du premier acte. Après un temps de stupeur, Ariane exprime sa douleur en une plainte (« Ah ! Le cruel ! Ah ! La cruelle ! ») tendre, douce, et dépourvue de haine : « je ne vivais que par lui, et je serais morte pour elle [?] oh ! Qu'il doit souffrir de ne m'aimer plus ! Qu'elle doit souffrir de m'avoir trahie ! ». Mais Pirithoüs survient porteur de l'affreuse nouvelle : Phèdre, défiant Cypris, est morte, écrasée par la statue d'Adonis qu'elle tentait de détruire pour se venger. Ariane retrouve les accents de sa prière à Cypris du premier acte, mais la déesse refuse de ramener Phèdre à la vie. De nouveau, Ariane fait preuve de sa détermination : elle ira chercher sa s?ur bien-aimée, même trahie par elle, dans les enfers. Touchée par ses supplications (« j'ai subi la pire détresse : Phèdre morte et Thésée en pleurs ! ») Cypris promet de lui accorder son aide au sombre séjour.
L'acte quatre se déroule aux enfers. Rappelons que dans la mythologie, ce sont Thésée et Pirithoüs qui s'y rendent bien après l'abandon d'Ariane, pour ravir Perséphone.
La composition d'Ariane a commencé au début de la relation entre Massenet et Lucy Arbell. C'est pourquoi le rôle de Perséphone qui lui était dévolu a été progressivement étoffé, le compositeur se faisant une joie de faire travailler à son égérie le fameux air des roses. Quelques années plus tard, peut-être aurait-il écrit pour elle la partie de Phèdre, qui sait ? Mais pour défendre le personnage d'Ariane, rôle exigeant, il ne fallait pas moins que la sculpturale Lucienne Bréval, cette tragédienne lyrique qui subjugua tous ses contemporains, voix prodigue, qui débuta à l'opéra de Paris en 1892 dans Selika de L'Africaine, et y créera l'année suivante la Walkyrie en français sous la direction d'Edouard Colonne. Pour la petite histoire, Louise Grandjean, créatrice de son aimante sœur Phèdre, sera sa grande rivale à Bayreuth, Brünnhilde de Siegfried et du Crépuscule des Dieux soutenue par Cosima Wagner. Lucienne Bréval, finalement Kundry à Bayreuth en 1914, sera encore Grisélidis pour Massenet. Une interprète incandescente pour l'incandescente Ariane.
Pour lui tenir tête, rien moins que Lucien Muratore, dont les enregistrements qui nous sont parvenus prouvent la générosité vocale, qui outre Thésée, créera également le rôle-titre de Bacchus et Lentullus dans Roma, et incarnera également Werther en 1904, et Jean-François Delmas, le premier Athanaël, et créateur d'Amrou, du Mage. Une brochette de voix généreuses et de tempéraments ardents.
Conséquence de l'absence de vie aux enfers, tout tourne au ralenti. A Perséphone (contralto) seront dévolues des notes égales, noires, blanches, rondes, pas ou peu de rythmes rapides ou pointés. La reine du monde souterrain se lamente, elle regrette l'univers des vivants « Maintenant dans la gaine étroite / De mon trône et de mon devoir / Je me tiens, pâle et toute droite / Avec dans la main un lys noir ». Un ballet décrit l'arrivée d'Ariane et le duel des furies de Perséphone avec les grâces de Cypris.
Ariane s'incline devant la reine des enfers, et dans son intense émotion, ne chante plus : elle adopte une déclamation rythmée, c'est à dire que seul le rythme est noté sur la partition, pas la hauteur des notes, l'orchestre la soutenant sur une série de triolets. Cet effet est bien entendu conçu pour dramatiser le discours, mais fait également référence à la fois à la tragédie antique dont est issu le mythe d'Ariane et à la déclamation lyrique, source de l'opéra français.
Ariane, en échange de Phèdre, apporte une brassée de roses, qui un temps, rappelle le monde des vivants à la reine des enfers (air des roses). Phèdre, bourrelée de remords, refuse tout d'abord de suivre sa sœur, mais le pardon d'Ariane l'emporte. Dès leur départ, le monde infernal retourne aux ténèbres, et Perséphone reprend sa plainte.
Retour à Naxos pour l'acte V. Thésée hurle sa douleur, appelant alternativement Ariane et Phèdre, la baisse d'un demi ton sur la dernière syllabe de chacun de leur prénom rendant parfaitement l'impression de son abattement. Jusqu'au retour d'Ariane, il chantera dans une tessiture tendue (environ entre mi et si), une tessiture passionnelle. Catulle Mendès réussit le tour de force de nous rendre le personnage humain, et presque sympathique. Cet abandonnateur d'Ariane, ce ravisseur raté de Perséphone, ce père qui lancera la malédiction de Neptune sur son propre fils n'est ici qu'un homme perdu, ballotté par ses sentiments contradictoires :
Pirithoüs : Et si l'une revenait ?
Thésée : J'attendrais encore l'autre
Pirithoüs : que ferais-tu les deux venants ?
Thésée : je ne sais pas !
Traître au lit conjugal, traître au lit adultère,
Revoyant mieux, depuis que je ne les ai plus,
De l'une les beautés, de l'autre les vertus.
Ariane surgit, soutenant Phèdre. Elle la montre à Thésée. Cette fois, elle ne déclame plus, mais parle, l'orchestre se taisant : « Quoi ! Ariane, pour la donner à Thésée, ramène Phèdre des enfers ! Quoi ! Elle a fait cela ! ». Phèdre et Thésée, honteux de leur trahison, abjurent leur amour devant Ariane, éperdue de bonheur. Hélas, petit à petit, sans s'en rendre compte, ils sont attirés, comme aimantés l'un vers l'autre. Enlacés, ils montent dans la nef en partance vers Athènes, sans un seul regard en direction d'Ariane.
Celle-ci, désemparée, exhale sa douleur en reprenant la longue tradition, vieille de Monteverdi, du lamento : « Ils mentaient ! A quoi bon ? d'un cœur comme le mien / leur trahison loyale était presque exaucée? »
Les sirènes reprennent leur chanson du premier acte. L'opéra se referme sur lui-même, et sur un la aigu pianissimo, Ariane s'enfonce dans la mer, à leur rencontre.
Catherine Scholler.
Discographie
unique version (privée) existante :
Ariane : Stella Wright
Phèdre : Paula Anglin
Perséphone : Marion Lewis
Thésée : Alexander Morgan
Pirithoüs : Alan Rice
Pisa Opera Group Chorus & Orchestra
Direction Fraser Goulding
Londres 12 mai 1977
Le livret d'Ariane est téléchargeable sur ODB (grâce aux efforts conjoints de Catherine et Jacky) : cliquez ici
L'iconographie de ce dossier est tirée du site http://www.jules-massenet.com
Les volets précédents de cette série sur Massenet s'intitulent Il faut déringardiser Massenet et Les femmes de Massenet
Texte de Catherine Scholler, janvier 2005.
Copyright © de ODB Opéra Tous droits réservés.
