Chabrier 4 : Le Roi malgré lui
- Détails
- Publication : mardi 15 juin 2004 00:00
À l'ombre d'Espana1
De l'extinction du vaudeville et de l'opéra-comique
« S'il n'y avait pas de Pologne,
il n'y aurait pas de Polonais ! »
Ubu Roi, Alfred Jarry
Un roi exilé par décret maternel à la cour de Pologne, en proie au mal du pays, n'a qu'une idée en tête : fuir Cracovie et renoncer à la couronne qu'on veut lui faire porter. Informé par la jeune serve Minka des menées secrètes pour destituer le roi français, celui-ci rejoint les conjurés en prenant soin d'usurper l'identité d'un gentilhomme de la cour, le comte de Nangis, jeté en prison indûment sans autre forme de procès. Le postulant conspirateur après avoir prêté serment est accepté par le grand palatin Laski, chef de milice des partisans de l'archiduc Ernest d'Autriche. Mille et une situations aussi inattendues qu'inextricables l'empêcheront de recouvrer la liberté. Au terme de son escapade, Henri de Valois sera couronné Roi de Pologne malgré lui.
De cet itinéraire imprévu aux chemins en lacis, la figure noble du roi s'oppose à celle de Fritelli, tête de guignol engoncée dans son habit de chambellan et pris en écharpe entre deux feux. Confondu par le roi qui l'accuse de haute trahison, il doit le présenter au clan des conspirateurs sous sa fausse identité, mais d'abord à son ambitieuse femme, la Polonaise Alexina, jadis entrevue à Venise. Celle-ci, nièce du duc Laski, reconnaît sous les traits du Français en disgrâce, le jeune homme qui lui porta secours dans la cité des doges et dont elle est toujours amoureuse. D'ailleurs, il ne tarde pas à lui jurer son amour. Femme au tempérament ardent, contraire à son falot de mari, elle demeure résolue à chasser le roi, à la condition d'emprunter le costume de servante et fuir avec lui. Minka, la jeune serve du duc Laski, plus espionne qu'esclave, délatrice des manigances diplomatiques mais surtout éprise d'une passion inextinguible pour le comte de Nangis, se trouvera mêlée, dans tous les sens du mot, à ce complot aux faits cocasses et aux rebondissements multiples. Enfin Laski, l'instigateur du projet, homme sans scrupule, - le prototype du tyran ubuesque - n'hésite pas à l'instar de tous les conjurés pour faire avancer la cause, d'exiger par un « arrêt voté à l'unanimité » la mort du roi. Or, si les conspirateurs se conforment au protocole, la procédure manque de transparence et d'équité. La hardiesse du roi Henri, la démarche altière d'Alexina, la couardise de Fritelli, l'arrogance de Laski ainsi que la témérité de Minka animée par l'amour, enfin la vaillance et la fidélité de Nangis sont autant de chemins de traverse où s'entrechoque et s'anime ce théâtre aux fresques chargées. Cette farce aux proportions énormes mais non exempte de tendresse, ce feu roulant de boutades, de jeu de mots, de plaisanteries mais au dilemme «cornélien» saugrenu, finira dans la liesse générale. L'archiduc d'Autriche ayant renoncé au trône, le roi Henri règnera sur la Pologne. Et comme tout bon souverain qui sait se faire respecter et aimer, il inaugure son règne, partagé entre devoirs et amour en dispensant les faveurs accordées à sa cour. Nangis épousera Minka, l'usurpateur Laski sera pardonné et Fritelli sera nommé «par royal privilège» ambassadeur en France, éloignant le mari gênant de la belle Alexina qui saura distraire le roi, pour son bon plaisir, et le détourner quelque temps du « beau pays, pays du gai soleil. »
« Le rire est le propre de l'homme »
Aristote et François Rabelais
Cette aventure rocambolesque dont les péripéties abondent et se précipitent dans un maelström sonore, ressemble fort au théâtre de la Foire qui naquit au seizième siècle. Son histoire contient en substance les ingrédients qui font le sel d'une comédie loufoque, fraîche comme une improvisation. Les librettistes Emile de Najac et Paul Burani s'en sont donnés à cœur joie, faisant diversion par d'inénarrables imbroglios, d'impromptus où le coq-à-l'âne le dispute au quiproquo. Le jeu des personnages hauts en couleur, qui ne cessent de se chercher, de se poursuivre, de se faire des crocs-en-jambe, rappelle les turlupinades du théâtre populaire. Henri Bergson en a donné une définition univoque. « Le vaudeville est à la vie réelle ce que le pantin articulé est à l'homme qui marche, une exagération très artificielle d'une raideur naturelle des choses. »2
Dans les années 1880, l'opéra-comique, genre éminemment français essuie une crise majeure et d'aucuns prédisent sa mort prochaine. Le traumatisme subi par la France lors du conflit franco-allemand et les secousses sismiques qui suivirent la Commune et les premières années de la Troisième République, ont eu des répercussions profondes dans toutes les couches de la société, plus palpables encore chez certains musiciens. Troubles politiques, certes, et malaises esthétiques pour plusieurs. Le rire devient suspect, voire iconoclaste. Il s'agissait d'assainir le répertoire pollué par des parodies jugées indignes, de régénérer la société par le drame.
Victorin de Joncières se départit de ses droits en faveur de Chabrier de transformer un vaudeville en opéra-comique. Lui-même ne croit plus au genre, il constate que « L'ancien moule de l'opéra est brisé, et la forme que doit revêtir le nouveau drame lyrique n'est pas encore trouvée.»3 Même si l'édifice se lézarde, il est étonnant de constater avec quelle assurance Chabrier croit encore en son avenir. «On fera de l'opéra-comique, je le crois, encore longtemps, mais l'opéra est, j'en ai peur sans le regretter plus que ça, dans les brindezingues.» Mais bien avant, en 1856, Offenbach voulant ressusciter le « genre primitif et vrai », retraça son histoire. «L'opéra-comique en effet, qu'est-ce autre que le vaudeville chanté ? Le mot lui-même l'indique : œuvre gaie, récréative, amusante.» 4Malgré les transformations opérées à toutes les époques, le genre est moribond et condamné à plus ou moins brève échéance. La phalange la plus saillante de l'avant-garde l'associait à un genre périmé, une des causes de la décadence de la musique française, contraire au symbole de la « musique de l'avenir » au drame lyrique wagnérien. Théophile Gautier, dans la préface de Mlle Maupin ne dira pas autre chose : « nous nous plaisons à reconnaître que l'extinction du vaudeville et de l'opéra-comique, en France (genre national), serait un des plus grands bienfaits de la presse et du ciel. » Pourtant Chabrier retrouvait dans ce système de référence que sont l'opérette et l'opéra-comique, l'esprit français de toute une tradition. «Il fait faux bond à la compagnie et se dérobe avec beaucoup de grâce. » écrivit avec une certaine pointe d'ironie Heugel (H. Moreno) au lendemain des représentations du Roi malgré lui. « Il a préféré, dans une pirouette, faire un retour vers l'Étoile, l'opérette de si joyeuse mémoire qui marqua ses débuts dans la carrière musicale. » Au vrai, Chabrier empruntait le cadre du vieil opéra-comique, mais pour transposer dans un langage nouveau toutes les audaces très personnelles de sa technique. « C'est certainement de la musique d'aujourd'hui ou de demain, mais pas d'hier » déclarait-il, à propos de la romance. « Une œuvre qui chante éperdument et sur laquelle plane l'esprit de la romance, d'une romance sublimée » devait renchérir Francis Poulenc, grand admirateur de l'auteur d'España. L'a-t-on mieux compris dans ce cadre vieilli ? Il a réussi à mécontenter les uns et les autres. « Le wagnérien m'appelle réactionnaire et le bourgeois me traite de wagnérien. »
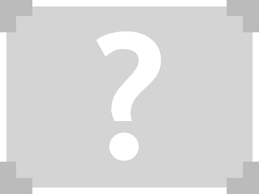
Les enfances du Roi
«Ma correspondance avec Najac et
Burani est un long livre à méditer. Vous le ferez graver à part.»
Emmanuel Chabrier à ses éditeurs.
Le vaudeville d'Ancelot, représenté en 1836, était tiré d'une chronique du seizième siècle relatant les hauts faits du duc d'Anjou qui devint roi de Pologne avant qu'il ne rentre en France sous le nom de Henri III. Le livret fut conçu dans la joie insouciante des jeux et des ris par Paul Burani et Armand Silvestre, premier lit d'une œuvre bouffe aussitôt refusée dans deux théâtres du Boulevard. Carvalho, directeur de l'Opéra-Comique promit d'ouvrir ses foyers et les feux du plateau au petit gavroche, mais chargea Emile de Najac de rajouter à son pedigree quelque titre nobiliaire. Un collaborateur « masqué » - parrain qui par la suite répudia son pupille, fut introduit. Il s'agissait du poète anarchiste Jean Richepin 5, l'auteur de La Chanson des gueux. Enfin Chabrier hérita du nourrisson emmailloté dans ses langes et le chatouilla de quelques coups de hochet. Trop de nourrices penchées sur son berceau avaient gavé de leur lait le dernier-né de Gargamelle. Et son registre sentait fort le grimoire.
La première eut lieu le 18 mai 1887, l’œuvre avait pris entre temps la forme plus respectable d'un opéra-comique. Le Roi malgré lui affronta à trois reprises les feux de la rampe. Une semaine plus tard, dans la nuit du 25 au 26 mai, la conjuration des éléments infernaux réduisait en cendre la seconde Salle Favart. Les flammes se répandirent comme une traînée de poudre. La partition d'orchestre du Roi malgré lui fut sauvée in extremis, ce qui occasionna une crise nerveuse à Chabrier. Le 18 novembre, l'ouvrage reparaissait au théâtre des Nations, transfiguré par de nombreuses coupures et déjà dans un texte quelque peu altéré. Mais dès sa sortie du théâtre, Vincent d'Indy avait signifié son incompréhension de la pièce à son ami musicien. « Trop de portes»?«Je ne comprends pas ». Plus tard, il qualifiera l’œuvre de « lugubre opérette » et ses réticences ne se limitaient pas seulement au texte. Cette gaieté apparaissait suspecte et semblait cacher quelque chose. Les mesures attentatoires n'allaient pas tarder à s'acharner sur ce chef-d'oeuvre incompris. En 1929, Albert Carré, partageant l'idée générale que le livret ne valait rien, opéra un premier lifting. Il refit les scènes et la pièce connut un certain succès dans ses nouveaux habits. C'est cette version qui a servi de texte de référence dans la plupart des maisons d'opéra. 6 Conséquence immédiate de ces reprises, Maurice Ravel, chabriériste fervent, demanda l'autorisation à Mme Bretton-Chabrier de faire quelques « retouches qui en décupleraient l'effet », ayant décelé « certaines imperfections de cet orchestre génial ». Par bonheur, il renonça à son projet. Enfin, pour couper court à ces « visites » inopportunes, notons que le dernier maquignon en lice André Boll, ravauda avec zèle les corrections des dialogues de Carré qu'il jugeait trop longs et injecta dans la veine jugulaire du Roi, une nouvelle transfusion sanguine.
À la source du gai savoir
«L'écriture de Chabrier est relevée à chaque instant d'altérations capiteuses.Aucun musicien de notre pays n'a poussé aussi loin ce qu'on pourrait appeler la sensualité musicale, qui, bien au-delà de l'oreille, pénètre jusqu'aux fibres les plus profondes de notre sensibilité. »
Jacques Bourgeois
La physionomie solaire du Roi malgré lui s'épanouit dans les mouvements rythmiques ou comme le souligne le compositeur lui-même, dans la polyrythmie. Il émerge de l'opéra une sorte d'hilarité collective où le rire passe du ricanement à la bouffonnerie, de l'esprit le plus délié à la farce sans que jamais la musique ne perde ses droits à la souveraineté du jeu et de la joie qu'elle procure. Le gai savoir, porté par un fond dionysiaque suppose tout un côté folâtre, facétieux et plaisant. Expurger du texte une certaine dose de folie, voire une certaine sottise ou drôlerie, ce serait supprimer une des composantes fondamentales d'une œuvre née de l'accrétion des matières sonores. La rhétorique du gai savoir, se déploie dans la naïveté que Chabrier jugeait indispensable au véritable esprit de création : retrouver la saveur de l'enfance, s'ébattre et vivre dans la joie et la liesse, fuir la colère et la tristesse. « Il y a assez de choses embêtantes dans la vie, écrivit Renoir, pour que nous n'en fabriquions pas encore d'autres. » Et c'est le même état d'esprit qui anime l'allégresse scintillante de sa musique.
Dès les premières mesures du Prélude, ce sont d'abord les vents seuls dans la limpidité de l'orchestre qui se font entendre comme un lointain appel, suivi du motif central de la Conjuration aux tournures modales archaïques et puis par un changement de rythmes, l'exposition du Chœur des soldats. Partout, la clarté de l'instrumentation jaillit, un contact sensoriel nous transporte. Une prodigieuse richesse sonore parcourt les trois actes sans interruption. Parfois masquée par l'ombre de la pièce, la revoilà qui réapparaît en pleine lumière ou dans certaines nuances de la palette du coloriste. Peu de musiciens de sa génération ont compris à ce point ce que les autres arts pouvaient apporter au sien. C'est le seul exemple dans toute l'histoire de l'opéra où la musique constitue le sang, l'os et la moelle et procure des plaisirs charnels dus à elle seule. Le Roi malgré lui est un joyau mésestimé. Les morceaux les plus saillants qui nous restent en mémoire foisonnent à toutes les pages de la partition. Ludique magicien des sons, saltimbanque véloce capable d'animer un tableau aux mille détails.
L'entrée de Minka et toute la scène qui précède sa romance « Hélas, à l'esclavage » est d'une absolue beauté et les vocalises rivalisent dans les mêmes vertiges avec celles de l'alouette. La romance du roi, « Cher pays, pays du gai soleil » pleine de nostalgie ne lui est pas inférieure. Et que dire de la Fête polonaise qui ouvre le deuxième acte où l'on conspire sur un pas de danse ? Une explosion de couleurs vives : Mazurka, Valse, Duos, le nocturne de Minka et d'Alexina, tout l'ensemble de la Conjuration déjà cité au Prélude On ne peut passer sous silence « Il est un vieux chant de Bohème », le vieux chant tzigane de Minka accompagnée des jeunes filles et la Danse slave au troisième acte. Tant de trésors n'ont pas empêché de mettre à l'écart cette œuvre unique.
«Jamais un artiste n'aura plus adoré, plus
cherché que moi à honorer la musique,
nul n'en aura plus souffert,
et j'en souffrirai éternellement.»
Emmanuel Chabrier
Le plaisir est immédiat, léger, moqueur, nerveux, divin. Nous avons besoin de cette franche gaieté, du rire rabelaisien, du gai savoir musical. Une plus grande connaissance peut contribuer à l'admiration esthétique de son œuvre même si celle-ci témoigne de la passion immédiate de la vie. Elle s'épanouit sous des aspects les plus variés mais toujours marquée du même sceau, à mille lieues de celle de Wagner qui malgré lui, est à l'origine de sa décision de devenir un compositeur à part entière.
Comment éviter la pierre d'achoppement ? En premier lieu, revenir à la version primitive. De tous les dangers exposés, Chabrier sortit vainqueur et évita par quelques sauts périlleux les croche-pieds qui parsèment la pièce. Les obstacles nombreux et variés, au lieu de scléroser l'inspiration du musicien ont au contraire éveillé ses sens et attisé sa verve et son génie. À n'en point douter, à l'instar d'Espana, le Roi malgré lui est un joyau musical flamboyant. Et c'est en endossant les étoffes vieillies pailletées d'oripeau que la musique revêt son habit de lumière, s'élève au-dessus de la mêlée et triomphe de tout. Une comédie aux détours forcés, parfois laborieux mais qui a le bonheur de faire ressortir plus que tout autre la musique d'un très grand compositeur.
Notes
1 Référence à l'ouvrage de Piotr Kaminski, Mille et un opéras. Fayard 2003.
2 Henri Bergson. Le Rire.
3 V. de Joncières. Revue musicale. La Liberté, 14 avril 1879.
4 Le Ménestrel. Concours pour une opérette en un acte. 27 juillet 1856.
5 Jean Richepin (1849-1926). Auteur des livrets de La Glu de Gabriel Dupont en 1883, de Nana Sahib 1884 dont Massenet écrivit la musique de scène, du Mage (1891) du même compositeur et du Chemineau (1897) de Xavier Leroux.
6 L'intégrale parue chez Érato sous la direction de Charles Dutoit puise toutefois aux deux versions. L'enregistrement ne contient aucune scène parlée.
Texte rédigé par Jacques Hétu, 2004.
Copyright © de ODB Opéra Tous droits réservés.



