Pierre Gaveaux (1761-1825)
- Détails
- Publication : mercredi 22 octobre 2003 00:00

Portrait du premier Jason, de Béziers à l’asile
C’est à Béziers, le 9 aout 1761 que Pierre Gaveaux, le premier Jason de Cherubini, voit le jour. Il chante 10 ans dans la maîtrise de la cathédrale de sa ville natale, d’abord dans le chœur, dès l’âge de 7 ans, puis comme soliste à partir de 17 ans. Il se destine alors à la prêtrise. Il étudie le latin, la philosophie et la composition avec l’organiste de la cathédrale, l’abbé Coulais. A la mort de l’évêque de Béziers, il quitte sa ville natale pour devenir premier ténor de la maîtrise de la cathédrale Saint-Séverin de Bordeaux. Il parfait sa formation musicale auprès de Franz Beck et compose des motets. Il étudie l’œuvre de Pergolèse. Il abandonne bientôt ses projets de carrière ecclésiastique et devient chef d’orchestre et ténor du Grand-Théâtre de Bordeaux.
Il se lie d’amitié avec son confrère Garat, le premier ténor « star » de l’histoire de la musique en France. Il fait une tournée dans le Midi de la France en 1788 qui passe par Montpellier avant de « monter » dans la capitale. Le 26 janvier 1789, il inaugure le Théâtre de Monsieur, dans la Salle des machines des Tuileries, avec Le Avventure Amorose d’un auteur napolitain Giacomo Tritto. Parallèlement à ses activités de soliste, il s’adonne à la composition et alterne ainsi ses deux activités complémentaires. Il chante avec un vif succès des opéras parodiés de Paisiello, L’Infante de Zamora (1789) et le Valet rival et confident (1790). Le Mercure de France du 20 février 1790 loue à la fois ses talents de chanteur et de comédien :« M. Gavaux, qui a déjà été distingué par sa manière de chanter, a joué fort gaîment le rôle du valet »
Il rentre dans l’histoire de la musique le 18 juillet 1791 en créant le rôle de Floresky dans la Lodoïska de Cherubini, un joyau trop méconnu qui n’est toujours pas parvenu à s’inscrire au répertoire courant malgré une résurrection somptueuse à la Scala de Milan sous la baguette de Ricardo Muti.
En tant que ténor, il est très actif pendant la période révolutionnaire. En septembre 1791, il participe au Théâtre Feydeau à une “folie en vers”, Le Club des Bonnes gens, qui est interdite pour atteinte au patriotisme. Peut-être est-ce pour se dédouaner de toutes suspicions réactionnaires, qu’il compose, quelques mois plus tard, un hymne à l’Etre Suprême. En 1792 toujours, il remporte un triomphe avec son premier opéra monté à Paris : L'Amour filial. Cet ouvrage va rayonner dans toute l’Europe : Bruxelles, Cologne et Rotterdam en 1795; Berne et Moscou en 1809 l’entendent dans l’original français tandis que la version allemande de C. A. Herklots est donnée à Berlin et à Hambourg en 1796. Les traductions se multiplient : il en existe même en danois (Copenhague, 1797 et Stockholm 1807) et en polonais (Varsovie, 1808 )
L’an I, c’est à dire 1793, est aussi une année marquante pour lui. Non seulement, il crée le premier Roméo de l’histoire de l’opéra français(on sait que l’époque redécouvre Shakespeare avec avidité), celui de Daniel Stiebelt, mais il fonde avec son frère Simon une librairie musicale, au passage Feydeau, sous l’enseigne de “A la Nouveauté". Il devient ainsi l’éditeur de ses propres oeuvres.
Le 19 janvier 1795, on chante pour la première fois son Réveil du peuple. Les paroles de Jean-Marie Souriguière de Saint-Marc s'en prennent aux Jacobins et s'opposent à La Marseillaise. En voici les premiers couplets que tout le monde connaît alors :
Peuple français, peuple de frères,/ Peux-tu voir sans frémir d'horreur / Le crime arborer les bannières/ Du carnage et de la Terreur ? ... Le jour tardif de la vengeance / Fait enfin pâlir vos bourreaux !
Ce chant est interdit le 8 janvier 1796 (18 nivôse an IV) par le Directoire. Pour autant, Gaveaux ne tombe pas en disgrâce. La saison 1797 est même particulièrement faste pour lui: Tout Paris se presse pour l’entendre dans Belfort des Visitandines de Devienne et il aborde le rôle qui le fait passer à la postérité, celui de Jason, le 13 mars 1797 au Théâtre Feydeau.
Le 19 février 1798 son ouvrage le plus important en terme de fortune artistique voit le jour. Il s’agit de Léonore ou l’Amour conjugal où il tient lui-même le rôle principal, Florestan. [Le livret est en ligne sur Gallica] On sait que Paër (1804), Mayr (1805), et surtout Beethoven avec son unique opéra, Fidelio (1805) feront plus que s’en souvenir. Le 20 décembre 1800, son s’inspire d’un mélodrame de Guilbert de Pixérécourt repris 27 ans plus tard pour un un livret mis en musique par Donizetti, Gli Esiliati in Siberia et ressuscité par le Festival de Radio-France en 2001.
Le 16 janvier 1800, Cherubini fait de nouveau appel à lui pour la première mondiale de son nouvel opus : Les deux journées, une œuvre qui se maintiendra à l’affiche jusqu’en 1830 et qui traversera même l’Atlantique pour des représentations new-yorkaises en 1827. Peu à peu Gaveaux, que sa voix commence à trahir, va abandonner les rôles de premier plan. En 1804, il devient chantre de la Chapelle impériale. La même saison il compose Le Bouffe et le tailleur, un opéra-comique joué jusqu’en 1899. Il est associé à une création majeure le 17 février 1807, celle du Joseph de Méhul, un des ouvrages-phares de la période. Lui-même conquiert une dernière fois le public parisien en 1808 avec son Echelle de soie dont le livret d’un certain François-Antonin-Eugène de Planard sera repris par Foppa pour une « farsa » de Rossini : La scala di seta.
En 1812 Gaveaux est victime d’une première crise de folie suivie d’une rémission de 1813 à 1816. Il regagne pourtant sa boutique et se remet à l’écriture. Toutefois, son Pygmalion d’après J. J Rousseau, reste inédit peut-être parce qu’on avait peur qu’il ne puisse soutenir la comparaison avec celui de Rameau. Ce qui ne fut pas le cas d’Une nuit au bois, ou le muet de circonstance, sa dernière partition qui connaît les feux de la rampe en 1818 puis, très rapidement, un oubli aussi rapide que définitif. Quelques semaines après cette ultime création, Gaveaux sombre définitivement dans la folie. Il finit sa vie à l’hôpital des fous avant de mourir, le 5 février 1825, près de Paris, à Charenton-le-Pont. Il laisse une veuve, Emilie Gavaudan (1772-1840), elle-même cantatrice, une trentaine de partitions et le souvenir d’un ténor au goût très sûr. Il apparaît à la fois comme un héritier de la vieille école italienne et l’une des figures les plus éminentes de deux genres nouveaux; l’opéra-comique à la française, le drame romantique.
Iconographie
Pierre Gaveaux / Edme Quenedey, d'après le physionotrace (aquatinte de 1821 ; dimensions : 24 x 19 cm) Conservée à la Bibliothèque nationale de France, Richelieu Musique fonds estampes Gaveaux 001. Image numérique Gallica.
Discographie sélective
¤ Médée
- Patrick FOURNILLIER, 1995 (NUOVA ERA) (version orginale en français avec les dialogues parlés)
¤ Lodoïska
- Olivero de FABRITIIS, 1965 (Nuova Era)
- Riccardo MUTI, 1991 (Sony)
¤ Les deux journées
- Thomas BEECHAM, 1947 (INTA'GLIO)
- MULLER-KRAY, 1960
- Christoph SPERING, 2000 (opus 111)
¤ Joseph
- Claude BARDON, 1989 (CDM)
Un air de Gaveaux a été enregistré par Regina Reznik,
Dieu d'Israel, tiré de l'Enfant prodigue(Sony/60784). Enregistrement de 1967, réédité en 1998.
Liens utiles
- Liste des opéras composés par P. Gaveaux, sur Operone
- Texte et musique du "Réveil du peuple"
- Livret français de Médée
Texte © Jérôme Pesqué, Octobre 2003.
(N'oubliez pas de consulter régulièrement la base de données extraordinairement riche de Jacky, sur ce site.)
Copyright © de ODB Opéra Tous droits réservés.
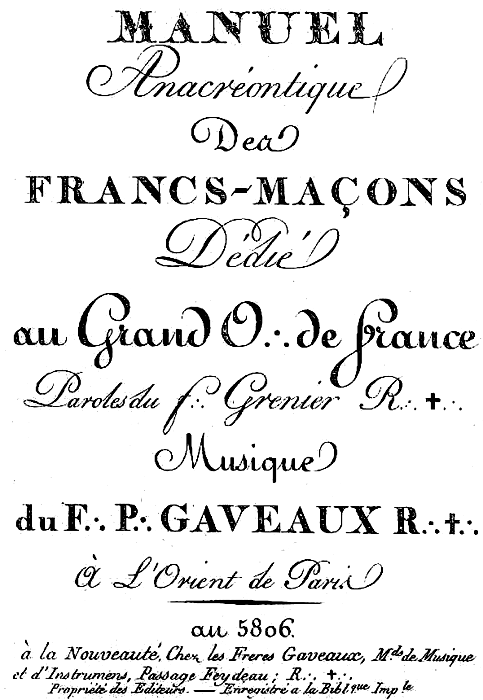

![Pierre Gaveaux Edme Quenedey [...] btv1b8420230f](/joomfinal/images/Dossiers-ODB/PierreGaveaux/Pierre_Gaveaux_-_Edme_Quenedey_[...]_btv1b8420230f.JPEG)